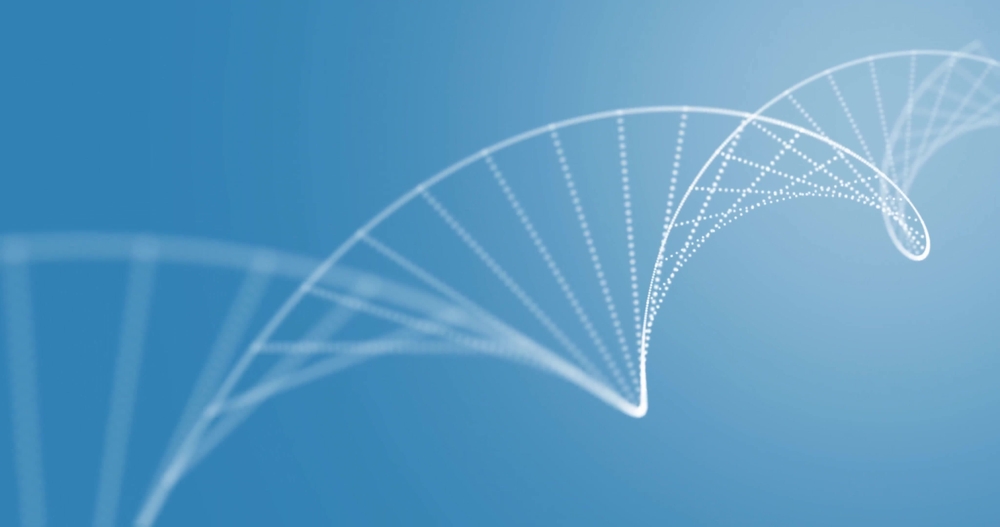Les articles s’enchaînent, souvent à charge, relayant des études aux méthodologies discutables ou aux conclusions alarmistes, sans mise en perspective scientifique rigoureuse. Dernier exemple en date : un article publié le 14 août 2025 affirmant que le vapotage sans nicotine pourrait modifier le crâne de fœtus. L’étude citée, menée sur des souris, observe des variations morphologiques après exposition à des solvants présents dans les e-liquides. Mais aucune donnée ne permet d’extrapoler ces résultats à l’humain, et encore moins de conclure à un danger avéré. Pourtant, le titre et le ton de l’article laissent peu de place au doute : le vapotage serait une menace pour les femmes enceintes, même sans nicotine !
Quelques jours plus tard, un autre article évoque une méta-analyse de 56 études sur le vapotage chez les adolescents. Là encore, le propos est anxiogène : troubles respiratoires, dépression, addiction, tout y passe. Mais la méta-analyse agrège des études aux méthodologies hétérogènes, souvent observationnelles, sans distinguer usage régulier, occasionnel ou expérimental. Le lien de causalité entre vapotage et troubles mentaux reste flou, mais le doute est savamment instillé.
Ce traitement médiatique pose problème. D’abord parce qu’il ignore les bénéfices avérés de la vape dans le sevrage tabagique. Dans les pays où la cigarette électronique est intégrée aux politiques de santé publique, la prévalence tabagique chute. Et les études en ce sens ne manquent pas mais elles ne semblent pas intéresser la rédaction de Science & Vie. Ensuite, parce qu’il alimente la confusion chez les fumeurs mais aussi les non-fumeurs, qui hésitent à passer ou à recommander à leur proches une alternative pourtant moins nocive.
La science mérite mieux que des titres sensationnalistes. Informer, c’est aussi contextualiser, nuancer, et reconnaître que tous les usages ne se valent pas. La vape n’est pas parfaite, mais elle n’est pas le fléau que certains voudraient dépeindre. À force de diaboliser, l’objectif semble de plus en plus de détourner les fumeurs d’une solution efficace — et finalement de les renvoyer à la cigarette, bien plus meurtrière. ●
La France peut désormais interdire les pouches.
C’est donc le 27 août dernier, alors que le pays tournait au ralenti et que les débats publics sont en sommeil, que la France a obtenu l’autorisation d’interdire sur son territoire les sachets de nicotine, aussi appelés « nicotine pouches » ou « snus ». Une décision lourde de conséquences, rendue possible par un silence opportun de la Commission européenne et des États membres, après une procédure qui soulève de sérieuses questions sur la transparence et la rigueur du processus.
Tout commence en février, lorsque Paris notifie à Bruxelles son projet d’interdiction. Or lorsqu’un État souhaite interdire sur son territoire un produit légal dans d’autres pays membres, il doit attendre une période de 3 mois avant d’appliquer sa mesure pour laisser le temps à d’autres membres de s’y opposer. C’est ce qu’ont fait plusieurs pays — Roumanie, Grèce, Slovaquie, Tchéquie, Suède et Italie —, estimant que la France n’avait pas apporté de preuves scientifiques suffisantes sur la dangerosité de ces produits. Leur intervention a ainsi prolongé la période de statu quo jusqu’au 26 août, empêchant temporairement la mise en œuvre de la mesure et obligeant la France à apporter des réponses aux questions soulevées.
Une variante de la stratégie de la chaise vide
Plus rien jusqu’au 21 août, soit cinq jours avant la fin de cette période où la France décide de répondre à ces objections. En plein été, alors que les institutions tournent au ralenti, les pays concernés n’ont que quelques jours pour réagir. Résultat : aucun retour. Ce silence, bien que non équivalent à une approbation, permet toutefois à la France d’aller de l’avant. Cette méthode, bien que conforme aux règles, trahit l’esprit de concertation défendu par l’Union européenne en privant le débat public d’un échange essentiel sur un sujet de santé publique majeur. La France peut désormais traduire cette autorisation en texte de loi en la soumettant à son parlement.
Pour rappel, les sachets nicotinés ne sont pas des produits anodins. Dans les pays nordiques, notamment en Suède, leur usage est associé à une baisse spectaculaire du tabagisme et des maladies liées au tabac. Moins nocifs que la cigarette, ils représentent une alternative crédible pour les fumeurs en quête de sevrage. Interdire ces produits revient encore une fois à fermer une nouvelle porte vers la réduction des risques, au profit d’une politique de prohibition dont l’inefficacité est bien documentée.
Dans un pays où le tabac tue encore 75 000 personnes par an, chaque outil de sortie doit être considéré avec sérieux. La précipitation et le manque de dialogue ne peuvent remplacer une stratégie fondée sur la science, la transparence et l’intérêt général.
Cachez ces arômes que je ne saurais voir.
Le ministère de la Santé français poursuit sa politique volontariste de régulation des produits de la vape, fondée sur une série d’interdictions et de mesures fiscales. Après l’interdiction des puffs, les restrictions d’usage dans certains lieux publics, les projets de taxation et la réduction des taux de nicotine, c’est désormais la question des arômes qui revient sur le devant de la scène. Jugés trop attractifs pour les jeunes, et en particulier les mineurs, certains arômes sont qualifiés de trop « ludiques » ou trop « sucrés ». À terme, les saveurs fruitées, bonbons ou pâtissières pourraient tout simplement disparaître du marché.
Le gouvernement envisage ainsi de distinguer les arômes dits « neutres », tels que le tabac ou la menthe, des arômes jugés récréatifs. Un e-liquide à la fraise, par exemple, serait considéré comme trop attractif, qu’il contienne ou non de la nicotine. Il devrait alors être retiré du marché français et interdit à la vente, que ce soit en boutique ou en ligne. Des sanctions sont également envisagées à l’encontre des fabricants et des revendeurs ne respectant pas ces nouvelles règles.
Une politique contestée par les experts
De nombreux spécialistes du sevrage tabagique s’inquiètent de ces décisions, qu’ils jugent contre-productives. Selon eux, priver les consommateurs d’arômes variés pourrait freiner les démarches d’arrêt du tabac, poussant certains à se tourner vers un marché parallèle, par définition non contrôlé et non régulé — voire à revenir tout simplement à la cigarette traditionnelle.
>À l’international, des pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande ont adopté des politiques antitabac intégrant la vape comme outil de réduction des risques. Résultat : la prévalence tabagique y a chuté de manière significative. Dans ce contexte, les mesures annoncées par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, interrogent. En voulant encadrer strictement les produits de la vape, le gouvernement risque de priver les vapoteurs français d’une alternative efficace, allant ainsi à l’encontre de l’objectif affiché : faire reculer, voire disparaître, le tabagisme. ●